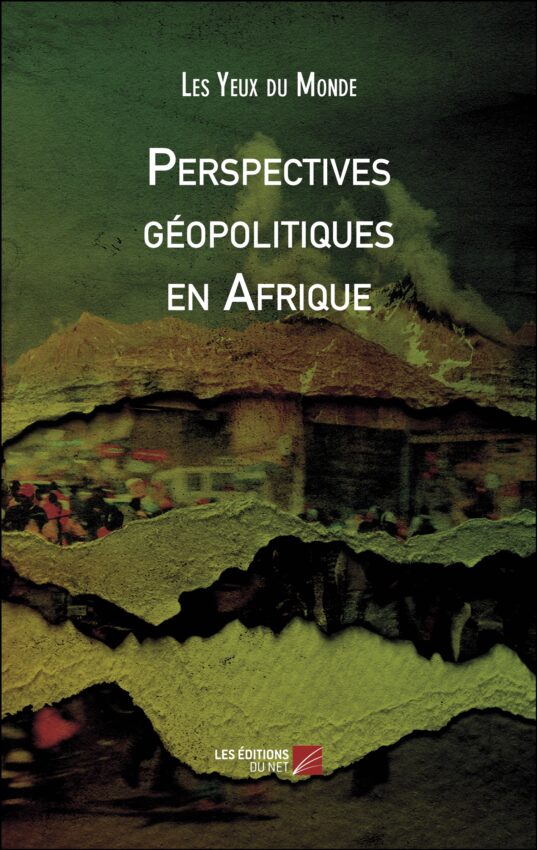Les Occidentaux peuvent-ils sauver l’Afrique ? – Marc-Antoine Pérouse de Montclos – Fiche de lecture

Auteur :
Marc-Antoine Pérouse de Montclos est professeur à Sciences Po Paris. Il est spécialiste de l’Afrique subsaharienne. Il travaille également avec de nombreuses revues spécialisées, comme Politique Étrangère, Cultures et Conflits, revue chargée de la lecture des relations internationales.
Objet :
Marc-Antoine Pérouse de Montclos souhaite donner à voir la complexité des relations entretenues entre l’Afrique et l’Occident, au sens large. Il s’agit donc là de retracer la genèse des relations entre ces deux entités, relations complexes, à la fois de complémentarité et d’inféodation d’une Afrique à l’égard d’un Monde Occidental.
Quatrième de couverture :
Le continent noir fait aujourd’hui figure de terre de mission pour des opérations internationales où les aspects militaires sont désormais indissociables des volets politique et économique. Il n’est cependant pas évident que ces opérations, qui tentent d’influer de l’extérieur sur des conflits qui sont avant tout des guerres civiles, aient des effets positifs. Leur bilan pour le moins contrasté oblige à se poser la question de la capacité des Occidentaux à régler les conflits africains.
Résumé :
1- L’entremise occidentale ou l’immixtion en Afrique Noire
L’Afrique Noire est véritablement « la terre des opérations de paix ». En effet, en considérant que l’Europe et l’Amérique du Nord ne sont pas sujettes à de telles opérations militaires, trois continents demeurent ainsi enclins à être le théâtre d’opérations de maintien de la paix : en premier lieu, l’Afrique, puis l’Asie ainsi que le continent américain.
L’auteur s’appesantit sur les préposés diplomatiques ainsi que politiques, lesquels légitimeraient de telles opérations armées. De son côté, l’Amérique Latine est tenue comme « chasse gardée » des Etats-Unis, et l’Asie, de par sa démographie pléthorique, occasionnerait des coûts d’intervention démesurément élevés. En outre, la présence de la Chine ainsi que de la Russie au Conseil de Sécurité de l’ONU, jouissant alors d’un droit de veto, entrave quelque intervention que ce soit, aussi bien dans le Caucase qu’au Tibet. L’Afrique noire est donc le seul continent pleinement « approprié », en témoignent les multiples actions armées au Liberia ou encore en République Démocratique du Congo.
Depuis la fin de la Guerre Froide, force est de constater que l’on assiste à une recrudescence des opérations de maintien de la paix. En fait, le recours à la force n’est plus seulement entériné pour défendre les Casques Bleus de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, mais également pour défendre les populations civiles : leur mandat est alors considérablement amplifié.
Dorénavant, les opérations militaires se voient doublées d’un volet économique et politique. Il ne s’agit plus seulement de séparer les belligérants, mais de chercher à tendre vers la signature d’un accord de paix, condition première de reconstruction de l’État ainsi que de l’appareil sécuritaire.
La Charte de l’ONU, datant du 26 juin 1945, pose deux principes contradictoires. En effet, d’un côté, le respect de la souveraineté territoriale. De l’autre, le droit d’intervenir militairement afin d’anticiper les diverses offenses à la paix mondiale. C’est finalement cette dernière configuration qui parait avoir prévalu dans les années 1990, pour ce qui est de l’Afrique en tout cas, en se bâtissant sur la notion de droit d’ingérence humanitaire, notamment formulée par Bernard Kouchner dans les années 1980.
En fait, à partir du début des années 1990, la notion de droit d’ingérence est graduellement acceptée par la communauté internationale, comme en témoigne l’adoption de deux résolutions par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies, justifiant l’ingérence internationale dans le cas des catastrophes humanitaires, et permettant, par là-même, une déviation par la communauté mondiale du principe de la souveraineté nationale.
2- Des opérations de paix hautement superfétatoires
Le dessein premier des multiples opérations armées est de s’entremettre entre les pays en guerre afin de transiger pour in fine « pacter ». Mais l’intervention extérieure, via l’interposition, risque de statufier les situations sans leur conférer de dégagement suffisant, ni régler les causes abyssales ayant drossé l’éclatement de la violence : « les opérations de paix onusiennes peuvent parfaitement retarder une crise et leur succès n’est pas évident ».
L’auteur semble ainsi souverainement sceptique quant à la fécondité de telles interventions. En effet, dans le cadre de conflits internes, il n’est généralement pas possible de les séparer géographiquement des populations vivant sur un même territoire. Le principe même d’interposition à la base des opérations de paix internationales perd alors de son aura, obligeant à tempérer sensiblement la vertu des susdites opérations.
En effet, un tiers des guerres civiles, seulement, s’achève grâce à une négociation, contre deux tiers dans le cas des conflits interprétatifs. Par conséquent, pour l’auteur, le pullulement incontestable des opérations de paix n’a pas radicalement changé les choses. Selon l’auteur, l’aboutissement le plus judicieux demeure véritablement la succès militaire d’une des parties engagées dans le conflit, annihilant, du même coup, la compétence militaire de la tierce partie et inhibant, enfin, le risque de rémanence du conflit. Ainsi, Marc-Antoine Pérouse de Montclos se demande s’« il ne vaudrait pas mieux appuyer le camp le plus susceptible de remporter une victoire militaire, de résoudre le différend politique et donc d’abréger les souffrances de la population ? »
Des brouilles sont survenues lors de l’éventualité d’une intervention française au Sénégal en 1999, suite au coup d’État du général Robert Gueï. Pratiquement, la France disposait de trois possibilités : la non-intervention (elle aurait ainsi été décriée pour avoir « abandonn(ée) les Africains à leur triste sort »), l’intervention timide ou l’intervention militaire (elle aurait alors été calomniée pour avoir promu l’ingérence néocoloniale). En clair, « dans tous ces scénarios, la France, quoi qu’elle fît, était perdante ».
Néanmoins, ce sont essentiellement les anciennes métropoles qui interviennent militairement. Les anciennes métropoles, via la réactivation des liens privilégiés hérités de la période coloniale, sont alors les plus aptes à agir militairement. Mais face à la rebuffade occidentale d’immoler des hommes dans des territoires lointains, les Etats occidentaux tendent à se délester sur les armées d’organisations régionales du tiers monde.
3- Des interventions militaires occidentales inopérantes
Selon l’auteur, de multiples paramètres expliquent le manque de résultats des missions de paix. Se pose en premier lieu un problème de définition exprès des opérations à choisir, pour obtenir un bilan convenu par tous. Se pose ensuite celui de la temporalité : quand doit-on estimer qu’un conflit est véritablement achevé, sachant qu’une part importante reprend plusieurs années après une période de trêve des combats. Aussi, d’autres facteurs, dont l’impact parait difficilement identifiable, peuvent également expliquer les difficultés, tels que l’éreintement des combattants. Corollairement, « il est très difficile de démontrer un lien de cause à effet entre le déploiement des troupes étrangères et le rétablissement de l’ordre ».
La conclusion de l’article, en réponse à la question posée par le titre, « les Occidentaux peuvent-ils sauver l’Afrique ? », convie alors à la circonspection. « Le constat ne porte pas à l’optimisme et invite à la modestie quant à la capacité des Occidentaux à résoudre les conflits africains ». D’autant plus que « plus une guerre civile dure longtemps, plus une opération de paix a de chances de réussir »…
Analyse :
Si une telle constatation peut, à brûle pour point, apparaître éhontée, elle est toutefois séante. L’article semble en effet réussi, en ce qu’il parvient à expliquer de manière limpide les différents enjeux corrélés aux opérations mondiales en Afrique : leur affirmation, leur accomplissement. Il répond donc à la question posée en titre, sans pour autant faire la différence entre peace keeping et peace making. Et voilà probablement la principale absence. Rendre explicitement compte de la différence existant entre le peace keeping (interventions de maintien de la paix de la première génération, se circonscrivant autour d’une médiation d’ordre internationale entre pays belligérants) et le peace making (opérations de paix de deuxième génération, les troupes internationales jouissant d’un recours plus large à l’usage de la force), aurait permis de peindre la situation avec davantage de clairvoyance et de justesse.
La conclusion de l’article est également contestable. A lire l’auteur, les Occidentaux ne devraient point s’ingérer, laisser la situation se régler d’elle-même, ou, au moins, la laisser se purifier : « plus une guerre civile dure longtemps, plus une opération de paix a de chances de réussir ». Le problème, c’est que l’on peut formuler le principe d’un devoir moral d’agir. Ce n’est peut-être pas la solution la plus perspicace, mais c’est celle qui semble la plus efficace. D’une part, on ne peut guère attendre indéfiniment qu’une situation se résolve, pour ce qui est des populations civiles, ce que l’on pourrait éventuellement légitimer par l’invocation du droit d’ingérence humanitaire évoqué dans le texte. D’autre part, et surtout, un conflit qui peut n’être que local ou régional, à son aurore, peut véritablement avoir des conséquences au niveau international, pouvant même aller jusqu’à menacer la paix internationale.